BNP Paribas et la reconstruction sociale par les comités d’entreprise et la Sécurité sociale

La Seconde Guerre mondiale a profondément bouleversé la société française, laissant derrière elle un pays ruiné, affaibli et confronté à d’immenses défis économiques et sociaux. Dès la Libération en 1944, un vaste chantier de reconstruction s’ouvre. Le secteur bancaire n’échappe pas à ce mouvement de réforme. Les archives de la Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie (BNCI) et de la Banque de Paris et des Pays-Bas nous éclairent sur cette période de refondation.
Refonder le pays : un projet social ambitieux
Porté par le programme du Conseil National de la Résistance (CNR), le projet de reconstruction dépasse la seule remise en état des infrastructures : il vise à redéfinir le modèle social français.
La création des comités d’entreprise : un tournant social majeur
L’ordonnance du 22 février 1945 impose aux entreprises de plus de 50 salariés de constituer un comité d’entreprise.
Composé de représentants élus du personnel et de membres de la direction, il est chargé de gérer les œuvres sociales et culturelles pour les employés, d’exprimer un avis consultatif sur les décisions économiques importantes et de créer un espace de dialogue formel entre direction et salariés.
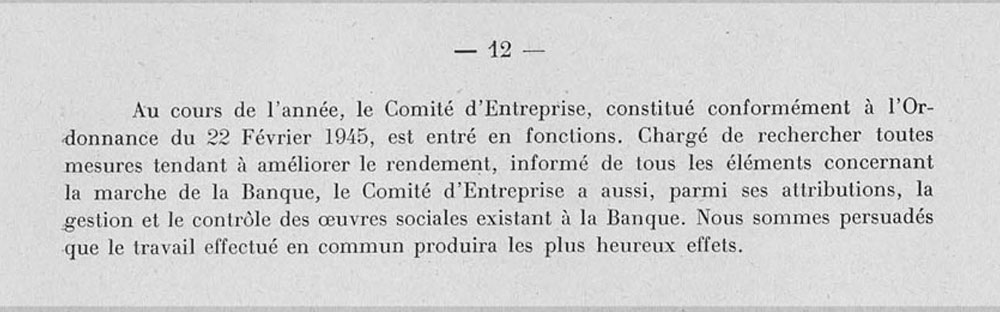
Déjà en 1944, le général de Gaulle défend l’idée que les comités d’entreprise doivent être un élément clé de la démocratie économique. « Il faut qu’une large fraction de ceux qui font vivre les entreprises participent à la marche de celles-ci. » Ainsi, ces nouvelles instances participatives visent à donner une voix aux salariés sur la gestion économique de l’entreprise et sur leurs conditions de travail.
Dans un secteur historiquement marqué par une organisation hiérarchique rigide et une forte concentration du pouvoir décisionnel, l’arrivée de ce nouvel organe consultatif constitue une rupture culturelle. Les banques adoptent rapidement ces instances qui deviennent un levier de dialogue et d’innovation sociale, particulièrement dans les périodes de modernisation accélérée du secteur.
Amélioration des conditions de travail
L’amélioration des conditions de travail est un axe fort des politiques sociales des banques ancêtres de BNP Paribas après-guerre. La réduction du temps de travail, les congés payés et les primes exceptionnelles en sont les piliers.
Les banques mettent également en place plusieurs aides pour soutenir les employés et leurs familles : caisses de secours, accès au logement grâce à des prêts avantageux.
Les CE des banques ont joué un rôle actif dans la promotion des loisirs et de la culture, avec la création de colonies de vacances pour les enfants des employés, comme celui de Landifer, ou l’organisation d’activités sportives et culturelles pour les employés, avec un accès à des bibliothèques.
Enfin, les comités d’entreprise ont mis en place des initiatives en faveur de la santé des employés. Des visites médicales régulières sont organisées pour prévenir les risques professionnels, ainsi que l’ouverture de cantines d’entreprise, pensées au départ pour garantir une alimentation équilibrée aux employés, à un coût modéré.
La participation active des employés à la gestion des œuvres sociales a permis de renforcer le lien entre la direction et le personnel et un sentiment globalement positif parmi les employés vis-à-vis des initiatives prises par les comités d’entreprise est souligné.
Une nouvelle ère de dialogue social
Mais dans les banques, les comités d’entreprise deviennent aussi des espaces où s’élabore progressivement une forme de concertation sur la vie interne des établissements bancaires.
Face à la transformation des métiers bancaires — automatisation naissante, diversification des services — les représentants des salariés se saisissent des comités pour négocier des conditions de travail adaptées, répondre aux enjeux de formation face aux évolutions technologiques, anticiper les restructurations et fermetures d’agences. Ce nouvel équilibre de dialogue contribue à démocratiser la gestion interne.
Les comités d’entreprise ont joué un rôle crucial dans l’amélioration des conditions de travail et de vie des employés après la Libération. Ces initiatives ont non seulement permis de stabiliser le personnel après la guerre, mais ont également contribué à institutionnaliser le dialogue social dans les banques ancêtres de BNP Paribas, un modèle qui perdure encore aujourd’hui.
La sécurité sociale, de l’obligation à la culture d’entreprise
En parallèle, les ordonnances d’octobre 1945 complètent le système d’assurances sociales voté le 5 avril 1928, mettant en place un régime social général de la Sécurité sociale, ayant pour vocation à rassembler l’ensemble des actifs (salariés des secteurs privé et public, exploitants agricoles, travailleurs indépendants et secteurs spécifiques d’activités).
La gestion interne des banques est bouleversée : ces dernières doivent déclarer leurs salariés au régime général, prélever et reverser les cotisations sociales, tout en s’assurant de la bonne information des salariés sur leurs droits.
La loi du 5 avril 1928 : un grand pas vers la Sécurité sociale : ce texte protège tous les salariés modestes en couvrant les risques maladie, invalidité, vieillesse et décès.
Pour les services des ressources humaines bancaires, cette mutation signifie une profonde refonte de leurs processus internes. Des équipes sont formées pour gérer les affiliations, les prestations santé ou retraites, et pour assurer une interface entre les salariés et les caisses. Progressivement, certaines banques vont au-delà de leurs obligations légales, en proposant des mutuelles internes ou des dispositifs de prévoyance supplémentaires, anticipant ainsi l’émergence des politiques modernes de protection sociale d’entreprise. Ce sera le cas des banques ancêtres du groupe BNP Paribas.
En intégrant les comités d’entreprise et la Sécurité sociale, les banques françaises adoptent bien plus qu’un cadre légal. Elles construisent un modèle de gouvernance sociale propre à la France. Ce modèle repose sur la négociation collective, l’intégration des salariés dans la stratégie d’entreprise, une prise en compte élargie des conditions de travail et de vie des salariés.
Héritages et continuité
La période 1945-1950 n’a pas seulement reconstruit les murs de la France, elle a aussi refondé son contrat social. 80 ans plus tard, un dialogue social structuré, la participation consultative des salariés et la protection sociale restent des piliers du fonctionnement interne des banques françaises, témoignant de cet héritage direct de la reconstruction sociale de l’après-guerre.
La Maison de Repos de Précy-sur-Oise : un havre de convalescence pour les employées

Située à 50 km de Paris, la maison de repos de Précy-sur-Oise était un établissement réservé au personnel féminin en convalescence. Avec une capacité d’accueil de 20 pensionnaires, elle offrait un cadre idéal pour se ressourcer et se rétablir après une intervention chirurgicale ou une maladie non contagieuse.
Cette maison de repos disposait de nombreuses prestations :
- Chambres confortables avec lavabos et eau chaude et froide
- Salle de jeux, salon, salle à manger et cuisine
- Infirmerie et salle de bains
- Jardin potager et terrain de repos
- Repas servis par tables de quatre
- Activités de loisirs : journaux, revues, poste de TSF, tourne-disques, jeu de ping-pong, jeux de société et bibliothèque











