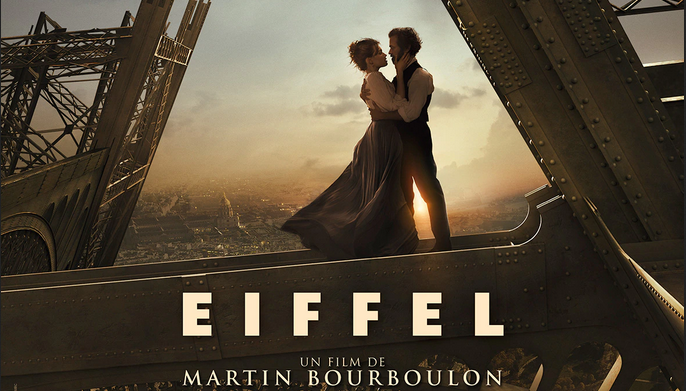La tour Eiffel, une prouesse industrielle du XIXe siècle en partie financée par des banques ancêtres de BNP Paribas

Lorsqu’il remporte le concours de l’Exposition universelle de 1889, Gustave Eiffel a déjà acquis une solide renommée grâce entre autres aux chantiers emblématiques de la Statue de la liberté et du Viaduc de Garabit (France). L’audacieux projet de la Tour Eiffel qu’il imagine à partir de 1886 entouré de son équipe d’ingénieurs novateurs relève à la fois du défi technique et financier. Retour sur les acteurs et les moments clés d’un chantier inscrit dans l’histoire de Paris.
Eiffel : de l’apprenti centralien au chef d’entreprise dans la construction publique
Si Eiffel (1832- 1923) échoue à entrer à l’Ecole Polytechnique en 1852, il est néanmoins admis à l’Ecole centrale des arts et manufactures à Paris. Il y choisit l’option chimie dans la perspective de succéder à son oncle, Jean-Baptiste Mollerat (1772-1855), à la tête de son usine d’acide acétique à Pouilly-sur-Saône (France).
Mais à la mort de ce dernier en 1855, des différends familiaux privent Gustave Eiffel de la direction de cette entreprise tant convoitée. Il se désintéresse alors de la chimie.
En 1856, Eiffel effectue un stage chez Charles Nepveu à Paris, centralien déjà reconnu pour ses traités sur l’organisation du travail et constructeur de machines à vapeur, outils, forges, chaudronnerie, tôlerie (industrie métallurgique). Grâce à ses compétences scientifiques et au réseau centralien, Gustave Eiffel devient très vite le bras droit de son maître d’apprentissage. Dès 1859, il dirige la construction du pont de Bordeaux et éprouve la technique du fonçage à l’air comprimé pour les piles du pont dans la Garonne sous le regard attentif de Charles Nepveu et de François Pauwels, propriétaire de la société Nepveu rachetée dès 1856. Tenu en très bonne estime, Eiffel est nommé ingénieur de la Cie Pauwels pour un salaire annuel de 9000 francs augmenté d’un bénéfice de 5% sur tous les marchés réalisés, le 1er septembre 1860.

Six ans plus tard, Eiffel reçoit une nouvelle marque de reconnaissance avec la commande passée par le comité d’organisation de l’exposition universelle : il est chargé de réaliser la partie métallique de la future galerie des Beaux-Arts et d’Archéologie (500 m de long sur 15 m de large) située sur le Champ-de-Mars. C’est aussi à ce moment qu’il rachète l’entreprise de son employeur, la Société Pauwels, engagée dans une liquidation en 1866. Dès lors, il participe aux chantiers internationaux les plus prestigieux : structure métallique de la Statue de la liberté en 1879, Viaduc de Garabit (Cantal- France) … Une série d’ouvrages remarquables qu’Eiffel mènera en s’entourant d’une équipe d’ingénieurs fidèles et novateurs, tels Maurice Koechlin (1856-1946) et Emile Nouguier (1840-1897) qui joueront un rôle essentiel dans la construction de la tour la plus haute du monde.
Eiffel et son équipe d’ingénieurs relèvent le défi du concours de l’exposition universelle
En prévision de l’Exposition universelle de 1889, le programme du concours sur les projets d’aménagement du Champs-de-Mars et de l’esplanade des Invalides est publié au Journal officiel le 2 mai 1886. L’article 9 précise que « les concurrents devront étudier la possibilité d’élever sur le Champs-de-Mars une tour en fer à base carrée, de 125 m de côté à la base et de 300 mètres de hauteur ».
Le projet porté par Eiffel est en concurrence avec la Tour soleil de Jules Bourdais, ingénieur et architecte, auteur avec Gabriel Davioud du Palais du Trocadéro pour l’exposition universelle de 1878. Avec l’enjeu, une violente campagne de presse oppose les ingénieurs et les architectes.
Mais Eiffel et ses comparses ont placé la barre haut. Nouguier et Koechlin veulent dépasser les prouesses techniques de la statue de la liberté et du viaduc de Garabit. Ils utilisent les calculs de résistance au vent et le principe de la poutre caisson réalisé à Garabit.
A la première présentation, G. Eiffel est dubitatif mais, au cours de l’été 1884, il est finalement convaincu par le projet, auquel est associé à présent Stephen Sauvestre (1846-1919), major de Centrale et qui a déjà collaboré avec Eiffel lors de l’exposition universelle. Le 18 septembre 1884, Eiffel, Koechlin et Nouguier déposent un brevet d’invention sur une « disposition nouvelle permettant de construire des piles et pylônes métalliques d’une hauteur pouvant dépasser 300 m ».
Maurice Koechlin (1856-1946), ingénieur de l’école polytechnique de Zurich et directeur du bureau d’étude de la Société Eiffel réalise le premier dessin de la Tour en 1884.Le 12 décembre 1884, un nouveau contrat est passé entre les trois protagonistes selon lequel Eiffel devient seul propriétaire du brevet en échange de citer leurs noms sur tous les projets afférents à la tour et en leur permettant de percevoir 1% des droits sur le devis estimatif par le comité d’organisation de l’exposition universelle.
En coulisses, Eiffel a reçu le soutien d’Édouard Lockroy (1838-1913), ministre du commerce et de l’industrie et commissaire général de l’exposition universelle, Bourdais et son projet ne pouvant répondre à l’appel d’offres.
Malgré les délais très contraints, 107 projets sont déposés et soumis à la commission de 29 membres. Le 12 juin 1886, Eiffel est lauréat du concours avec quelques réserves : améliorer le mécanisme des ascenseurs et veiller aux phénomènes électriques susceptibles de se produire (foudre). Eiffel se tourne vers trois fournisseurs nouveaux pour ces ascenseurs : Roux-Combaluzier, Otis et Edoux. Il doit aussi financer ce gigantesque chantier.

Financement de la Tour Eiffel : la Banque Franco-Egyptienne entre en scène
En 1888, le coût du chantier de la Tour Eiffel est estimé à 6,5 millions de francs en 1888, tandis que les pouvoirs publics ne peuvent couvrir la dépense qu’à hauteur de 1,5 millions de francs. Eiffel fait donc appel aux banques pour réunir les 5 millions de francs supplémentaires. Face aux réticences initiales de la Société générale à s’engager sur le projet, Gustave Eiffel finit par trouver un interlocuteur réceptif en la personne d’Ernest May, directeur de la Banque franco-égyptienne, un établissement ancêtre de BNP Paribas.

La Franco-Egyptienne s’engage sur le projet en signant un protocole d’accord le 26 juillet 1888. Afin de répartir les risques de l’opération, Ernest May, se tourne alors vers d’autres établissements bancaires : le crédit industriel et commercial (CIC) et la Société générale. Les 3 établissements bancaires forment alors un syndicat et signent le contrat définitif avec Eiffel le 3 septembre 1888. La Banque Franco-Egyptienne est donc bien cheffe de file de l’opération. Gustave Eiffel engage ses droits d’exploitation de la Tour dans l’opération et reçoit en échange des actions de la Société de la tour Eiffel, proportionnellement à l’avancement des travaux. Ce sont ces trois mêmes banques qui participent le 28 février 1890 à la création de la Compagnie des établissements Eiffel, la société de construction de Gustave Eiffel.
La Tour Eiffel, monument emblématique de la Ville de Paris, témoigne du rôle majeur que jouent les banques dans l’accompagnement financier des grands projets d’aménagement du paysage urbain.
Quels sont les liens de la Banque Franco-Egyptienne avec BNP Paribas ?
La Banque franco –égyptienne a été créée en 1870 par un des membres de la famille Bischoffsheim, Louis-Raphaël (1800- 1873) pour financer notamment la dette égyptienne. Avec la banqueroute de l’Egypte, elle se tourne vers d’autres financements. Le Crédit industriel et commercial (CIC) entre dans son capital. Albert Rostand, administrateur du CIC, en devient président.
Le 17 mai 1889, la Banque franco-égyptienne, où Paribas est devenu un actionnaire influent, apporte son capital à la Banque internationale de Paris (BIP). La Banque internationale de Paris, contrôlée par Paribas, fusionne elle-même en 1901 avec la Banque d’Afrique du Sud pour former une banque d’affaires dirigée par l’ancien ministre des finances Rouvier, la Banque française pour le commerce et l’industrie (BFCI). Celle-ci est intégrée en 1922 dans la Banque nationale de crédit, ancêtre de la BNP.
Notre groupe est successeur de la Banque franco-égyptienne par ses deux composantes françaises, Paribas et la BNP. L’histoire du CNEP est liée indirectement à l’histoire de la banque franco-égyptienne. En 1889, la banque franco-égyptienne entre au capital de la Banque internationale de Paris (BIP) qui sera elle-même ultérieurement intégrée au CNEP.